
La laïcité et la religion font beaucoup parler d’elles à l’occasion d’«affaires » montées en neige par les médias (toujours et encore le « foulard islamique » ; Benoit XVI tirant dans les pattes de François, etc). Pendant ce temps, des chercheuses et chercheurs en sciences sociales travaillent ces sujets en profondeur, dans une invisibilité sociale presque totale.
C’est pourquoi, il n’est pas inutile d’attirer l’attention sur deux ouvrages de synthèse, parus pendant le dernier trimestre de 2019. Le premier a été écrit par Pierre Lassave. La sociologie des religions. Une communauté de savoir (éd. de l’EHESS, coll. « En temps & lieux »).Le second est un ouvrage collectif, La Sécularisation en question. Religions et laïcités au prisme des sciences sociales (Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de science politique »), issu d’un colloque international célébrant les 20 ans du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-PSL-CNRS). Ce dernier livre sera d’ailleurs présenté lors d’une manifestation au Campus Condorcet (salle du Conseil EPCC, 5ème étage du bâtiment Hôtel à Projets, du campus qui se trouve Cours des Humanités, 93322 Aubervilliers, métro front Populaire, RER B Stade de France) le jeudi 23 janvier de 15h. à 17 h. (et sera suivi par la visite d’une exposition photographique sur la « Pluralité du croire »).
416 pages pour le premier opus, 746 pour le second (dont il est possible d’acheter tel ou tel article pour 2€ sur le site des éditions Garnier), je vous l’accorde, il ne s’agit pas de tweets ! Et il est fort peu probable que ces ouvrages soient lus par un certain Donald T. Les éditeurs affirment ce sont les livres courts qui se vendent, dans « notre » univers marchand[1]. Et la réflexion, l’approfondissement, l’art de penser dans tout cela, où se nichent-ils ? Etre lectrice ou lecteur d’ouvrages longs et ‘sérieux’, c’est, un peu, être une/un guérillero des temps actuels. Souhaitons que cette « espèce » ne soit pas menacée d’extinction par les changements dus au réchauffement médiatique !
En 1953, Ray Bradbury avait écrit un roman de science-fiction Fahrenheit 451 (dont François Truffaut fit un beau film). Dans ce récit, les pompiers sont chargés non d’éteindre les incendies mais de brûler les livres qui, propagent des idées controversées, non conformes et, par cela même, empêcheraient les gens d’être heureux (dans une pensée commune). Souhaitons que le capitalisme financier n’arrive pas, par des procédés beaucoup plus habiles, à un résultat analogue ! Je m’inquiète d’entendre, d’un bout à l’autre de l’échiquier politique, mettre en avant le « commun », comme si la novation n’était pas, au départ, minoritaire et contestable. Et je félicite les éditeurs qui continuent, contre vents et marée, à publier de ‘gros’ livres, socialement considérés comme guère « sexy » (il faudrait décrypter, en ces temps de me-too !, cette expression qui continue d’être largement utilisée comme critère de tri entre ce qui va être mis dans « l’actu » et ce qui va être rejeté dans l’invisibilité médiatique). Bon, examinons nos deux ouvrages.
La sociologie des religions. Une communauté de savoir de Pierre Lassave donne, de façon très originale et sans mettre son esprit critique dans sa poche, un bilan de la constitution progressive de la sociologie des religions en branche disciplinaire des sciences sociales, dans la moyenne et même la longue durée. L’auteur commence par retracer son propre itinéraire, qui s’avère fort intéressant. En effet, dans une première vie, Lassave fut un spécialiste de sociologie urbaine et il a collaboré à diverses entreprises ministérielles, notamment à la modernisation des déplacements urbains. La sociologie des religions « est donc entrée par la bande dans [sa] boite à outils, pour comprendre le sens des trajectoires de certains spécialistes de la ville. » De là une seconde vie, où l’objet religieux est analysé « sur le tard », et où le regard extérieur persiste au sein même de l’engagement scientifique. Lassave entretient donc avec la sociologie des religions un rapport de distance et de proximité, qui me parait constituer le meilleur point de vue (au sens presque littéral du terme) possible pour pouvoir en rendre compte.
Il n’est donc pas question pour lui de traiter des diverses théories de sociologie des religions comme de réalités nébuleuses, se déplaçant tels des nuages dans le pur ciel des idées, mais de proposer une socio-histoire incarnée, qui approche cette « sous-discipline »[2] (souvent un peu marginalisée) des sciences sociales de façon elle-même sociologique. Le sous-titre « une communauté de savoir » l’indique clairement. Comme les autres sciences, la sociologie de la religion n’a rien d’une révélation qui constituerait une vérité définitive ; elle se veut œuvre humaine, avec tout ce que cela implique comme rapports de forces internes et externes, comme constitution d’une communauté spécifique, construisant ses propres règles et pratiques, pour produire, à travers maintes « controverses », un « savoir ». Et je vous recommande particulièrement le chapitre 7 où Lassave analyse certaines disputatio comme des analyseurs qui décryptent « ce que les autorités savantes tiennent pour acquis et les contingences par lesquelles la connaissance chemine »[3].
L’auteur effectue différents « petits tours du monde » panoramiques, et des zooms sur la situation française (ce qui lui permet de fournir beaucoup d’informations précieuses) en la replaçant toujours dans les mutations de la recherche mondiale, (surtout, il faut bien l’écrire, « transatlantique »). Il nous montre à quel point la construction de perspectives théoriques s’est liée aux différentes formes d’institutionnalisation de la discipline, aux réseaux savants qui se sont constitués, aux moyens qui ont pu être mis en œuvre, aux interactions entre chercheurs, dont certains ont acquis, pour un temps du moins, une influence plus ou moins déterminante. Et la réception différenciée des auteurs marquants d’autres pays colorise chaque histoire nationale de la discipline.
En France, de l’après seconde guerre mondiale aux années 1980-90, une génération de pionniers (dont un « corpus mémoriel » retrace les carrières) a orienté la recherche de façon décisive en créant et en développant le Groupe de Sociologie des religions (CNRS) et une revue, les Archives de Sciences Sociales des Religions, dont le rayonnement ne tarda pas à devenir international.
Si la génération pionnière est presque exclusivement masculine, la suivante, celle des « héritiers », nourrie par les contestations intellectuelles (et politiques) des années 1960-70, s’avère heureusement moins genrée, grâce notamment à Danielle Hervieu-Léger, qui a brillamment réussi à percer le « mur de verre ». Des années 1960 aux années 1990, le GSR double ses effectifs, et n’a plus le monopole de la sociologie de la religion, qui émerge également dans quelques autres laboratoires de recherches et certaines universités. Dans la dernière décennie du XXe siècle, le GSR lui-même se scinde en deux laboratoires distincts, chacun se liant à une institution prestigieuse de l’enseignement supérieur (EHESS et EPHE) : le CEIFR, Centre d’Etudes Interdisciplinaires des Faits religieux, « plutôt axé sur les formes dynamogènes de la modernité religieuse », et le GSRL, Groupe de Sociologie des religions et de la Laïcité (devenant ensuite le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), plutôt axé « sur les liens supraconfessionnels et la laïcisation des sociétés ». Une « troisième génération », aux « composantes multiples », prend maintenant le relai.
Dans tous les lieux institutionnels où elle se pratique, la sociologie des religions est devenue, de fait, pluridisciplinaire, concrétisant une ouverture, amorcée dès le départ. Pour Lassave la «sociologie penche davantage du côté du fonctionnement d’ensemble des institutions et des communautés religieuses alors que l’anthropologie peut s’attarder sur la nature symbolique des processus en cause, y compris ceux de la connaissance même. » Cependant ajoute l’auteur : « la perspective compréhensive et l’examen des régimes d’historicité » rapprochent « les points de vue. »
Il fallait donc retracer ce cheminement avant d’en arriver à l’analyse de « mots clés » où Lassave confronte les interprétations données par deux dictionnaires, un à « vocation encyclopédique », écrit par des savants de diverses disciplines(de la philologie à la philosophie), issue surtout des de facultés catholiques, l’autre, « à vocation plus critique », où des chercheurs en sciences sociales sont les auteurs prédominants. L’idée est très intéressante pour montrer à quel point la recherche reste en débat, ce qui ne signifie pas d’accorder aux diverses positions le même crédit scientifique. Parmi les notions présentées, retenons l’item « Dieu ». Pour le 1er dictionnaire, celui-ci est examiné dans la Bible, l’hindouisme et l’islam. Le second relie « Dieu(x) et divinités », insistant sur « la pluralité originelle des formes du divin ». Le 1er articule du normatif et de l’analytique, le second effectue une mise en perspective sociologique et historique de « Dieu(x) ». Cette problématique relevait du blasphème, quand la section des sciences religieuses de l’EPHE fut créée en 1886.Elle est acceptée aujourd’hui en France, mis à part quelques milieux extrémistes. Cela ne signifie pas que le caractère transgressif du blasphème ait disparu. Notre pays ne fait heureusement pas parti des Etats où son interdiction est effective, signe d’un pouvoir religieux maintenu. Mais il existe cependant, dans des milieux qui croient le combattre, une tendance à s’indigner devant des analyses critiques d’éléments d’un « sacré républicain », de fait considérées par certain.e.s comme des blasphèmes séculiers. En ayant montré l’ambivalence (à partir de documents incontestables) du Jaurès de la période combiste[4], j’en fais, actuellement, quelque peu l’expérience.
Dans sa conclusion [5], Lassave insiste sur la « fragilité » de la sociologie, en général, et de la sociologie de la religion en particulier, dans un contexte où « le marché de la communication fonctionne au dire d’experts qui ont fait de la performance publique leur métier et leur raison d’être. », où « la moindre explication sociale se trouve accusée (…) d’excuser tout crime, délit ou déviation et d’exonérer l’individu de sa responsabilité propre », avec une « confusion des plans entre le cognitif et le normatif » et un refus, au nom des impératifs de l’action de « l’analyse (…) de la complexité » ; où enfin « les appréciations négatives du fait religieux relèvent la tête ». Mais ces difficultés doivent être plus stimulantes que paralysantes et les sociologues des religions doivent continuer leur travail avec ténacité, en étant conscients du privilège qui reste le leur dans les pays démocratiques : pouvoir, au milieu de contraintes multiples, persévérer dans leurs recherches sans craindre de se trouver jeté.e.s en prison le soir même.
Second ouvrage, la somme collective du GSRL, La sécularisation en question. Religions et laïcités au prisme des sciences sociales, réunit 47 contributions qui sont autant d’exemples significatifs d’études générées par cette « communauté de savoir » dont parle Lassave. Quelques textes constituent d’ailleurs des passerelles avec son propre livre, tel celui consacré à Jean Séguy, une des figures du GSR dont l’œuvre n’est pas assez connue, ou ceux qui montrent les éléments de continuité et, au contraire, de novation entre le GSR et le GSRL , dont le travail de mise en perspective sociologique de la laïcité (pas encore vraiment socialement accepté[6]) a permis d’élargir le regard porté sur le religieux lui-même.
Le titre La sécularisation en question ordonnance autour d’une problématique transversale nombre d’études contenues dans l’ouvrage. Des années 1950 aux années 1980, l’épine dorsale de la sociologie des religions fut constitué par les théories de la sécularisation qui, toutes, d’une façon ou d’une autre, se focalisaient sur des indices convergents montrant un déclin social de la religion. Ces indices apparaissaient manifestes car un modèle industriel « sécularisateur » semblait alors s’universaliser à l’ensemble de la planète, dans ses deux versions conflictuelles : celle du capitalisme libéral et celle du socialisme étatique. La fin de la colonisation ne remettait pas en cause une tellle représentation. Au contraire : devenus indépendants, des pays dits du Tiers Monde se référaient à l’une de ces deux versions de société sécularisée.
Après avoir atteint le catholicisme, avec le Concile Vatican II, « la sécularisation interne » (c’est-à-dire l’acculturation des religions à « la » modernité) semblait s’étendre aux pays de culture islamique : En Tunisie, Bourguiba interprétait le djihad comme le combat contre le sous-développement. Le Mali indépendant devenait une république socialiste. Au Proche-Orient, le nationalisme arabe avait le vent en poupe. Etc. La problématique de la sécularisation reposait donc sur des bases empiriques solides. Son erreur a été d’avoir une dimension téléologique, c’est-à-dire de se prendre un tantinet pour une philosophie de l’Histoire, dont le cours serait linéaire. Les mutations du monde n’ont pas correspondu à ce schéma global. Selon moi, la spirale est une métaphore plus pertinente pour tenter d’aborder, avec précaution, le « cours de l’Histoire ». Mais la ligne droite a imprégné le « paradigme de la sécularisation ». Du coup, persistant dans son erreur, un de ses principaux théoriciens, Peter Berger, a parlé, au tournant du XXe et du XXIe siècle, de « désécularisation ». Le langage commun a adopté une autre expression : « le retour du religieux ».
Le GRL, et l’ouvrage célébrant ses 20 ans en témoigne une nouvelle fois, ne s’est jamais situé dans cette perspective, qui est d’autant moins pertinente qu’elle ne prend pas en compte qu’à la « modernité triomphante » a succédé « l’ultramodernité » traversée « par des logiques d’incertitudes dans une société-monde ». Lors de la troisième décennie du XXe siècle, la religion ne disparaissait pas du paysage social, tout comme la famille dont certains ont, à la même époque, proclamé la fin. De même qu’il existe des « familles recomposées », un double mouvement de décomposition et de recomposition est à l’œuvre dans le champ religieux. Plusieurs contributions le montrent, de façon très éclairante, à propos du judaïsme français, après le traumatisme du temps de Vichy. D’autres dossiers, sur des aires culturelles différentes, analysent des « bricolages » entre divers phénomènes religieux : l’étude des interactions entre christianisme et chamanisme en Sibérie notamment, ou encore la transformation des formes de prophétie et de voyance en Calabre. Bien plus qu’un « retour du religieux », des références issues des religions peuvent constituer un recours, aux orientations très diverses. Ainsi en est-il de la notion de « nature » qui, reprise dans un « héritage catholique », peut aussi bien connoter un « espace de liberté » qu’un « ordre à respecter en l’état ».
Il n’est vraiment pas possible de rendre compte de l’ensemble des contributions (à signaler, notamment, celles sur la Chine ou celle concernant l’articulation entre philosophie de la religion et sciences sociales). Mais il me semble nécessaire d’insister un peu sur la double dimension de cet ouvrage du GSRL : aux sciences des religions s’ajoutent, en étroite interconnexion, les sciences des laïcités, qui ajoutent aux sciences sociales, l’approche juridique (et, notamment, la comparaison entre leurs définitions respectives de la « religion »).
Les « laïcités » : le pluriel peut étonner, voire choquer. Pourtant, deux raisons l’exigent. D’abord, un simple constat empirique prouve que la dite « laïcité à la française » n’a rien d’une laïcité absolue (statut spécifique en Alsace-Moselle, loi Debré, fêtes catholiques chômées, diverses subventions indirectes aux cultes,…) et qu’elle se déploie de façon différente suivant les institutions (ainsi la sphère médicale et bioéthique fait l’objet de 2 études). Au niveau d’une approche plus synthétique, l’analyse d’«une religion civile à la catholique en France » dévoile un angle mort de la laïcité dans notre pays. Les difficultés de la « construction d’un islam de France » en indiquent un autre. D’ailleurs les « controverses » françaises actuelles autour de la laïcité montre que celle-ci fait l’objet de représentations divergentes et que sa définition ‘légitime’ constitue un enjeu politique et social, où le contexte joue un rôle idécisif. Sans oublier l’histoire bien spécifique de l’Algérie coloniale, pourtant composée de départements français, ni les « perspectives » de genre », où « trois types de laïcité se dégagent à travers les polémiques sur le foulard islamique et leur articulation avec l’égalité des sexes ».
Ensuite, si la France n’est pas que laïque, la laïcité n’est pas que française ! Curieusement, quand on parle des laïcités d’autres pays, on vous rétorque souvent : « Oui, mais ce n’est pas comme chez nous » ! Effectivement le Canada-Québec n’a pas de loi Debré, ni de cas de figure correspondant au Concordat d’Alsace-Moselle, ni même de dévolution gracieuse et indéfinie d’églises,… Il n’empêche, l’étude des « laïcités contrastées » d’un côté et de l’autre de l’Atlantique s’avère fort éclairante.
D’autres pays sont laïques à leur manière, et diverses formes de laïcité sont donc présentées. Au Mexique, la séparation date de 1859 et l’histoire de la laïcité mexicaine est passée par différentes phases, certaines très strictes. Depuis 1992 la laïcité mexicaine s’est libéralisée, plusieurs évolutions l’ont fragilisée et, en même temps, elle a été consolidée par son inscription dans la Constitution, en 2012. Le Brésil a, également, séparé la religion de l’Etat avant la France, en 1891, et les termes de la famille sémantique « laïcité » sont utilisés maintenant de façon très polysémique, avec la forte présence d’une pluralité religieuse, nouveauté dans pays de tradition catholique. En Turquie, la laïcité historique (inscrite dans la Constitution en 1937) n’a pas été séparatiste, mais a voulu étroitement contrôler l’islam. Aujourd’hui l’AKP n’a pas formellement remis en cause la laïcité turque mais a utilisé à son profit les liens maintenus entre l’islam et l’Etat. Ce parti insiste d’autre part sur les « racines musulmanes » de la Turquie. Et dans un Etat africain comme le Mali, constitutionnellement laïque, un débat est en cours sur l’insertion des associations religieuses dans la société civile, celles-ci se démarquant « des groupes islamistes étrangers qui sévissent depuis des années dans le nord du pays ».
Ces différentes laïcités nous interrogent également sur le « rapport jamais dénoué entre politique et religion » et la pluralité des interprétations de la « violence religieuse ». Celle-ci subsiste de plusieurs manières et le « conflit actuel entre sunnites et chiites » en est un exemple frappant, qui risque de « dégénérer en conflit régional, voire mondial ». La recherche de la « pureté » a toujours été marquée d’ambivalence, même si elle ne débouche pas forcément sur l’action violente. Et, contrairement à ce qu’a proclamé Valls, expliquer n’est en rien excuser ou justifier. Ainsi, il s’avère indispensable de connaitre le « processus historique qui a permis la diffusion de la doctrine de la salafiyya » et de comprendre les raisons du « désir d’une loi divine, aussi absolue qu’irréfragable ».
Une tension peut surgir entre quête de l’absolu et respect des droits de l’autre. Entre « la conception américaine (…), qui fait de la liberté religieuse le premier des droits civils et politiques » et une conception « émanant essentiellement » de nations « non occidentales, qui souhaite limiter la liberté d’expression » au nom du respect de la religion, la « conception européenne (…) assortit la défense de la liberté de religion et de conviction à des limites légales » (interdictions de l’incitation à la haine et respect d’un ordre public démocratique). Et ce gros ouvrage se termine par une réflexion sur « laïcité, religions et débat public » où l’on retrouve le point de départ de cette Note : comment parler avec sang-froid de ces sujets complexes à l’heure du réchauffement médiatique ?
[1] A ce sujet, je vous recommande la réflexion stimulante de Michael Sandel (et de son préfacier J.-P. Dupuy), Ce que l’argent ne saurait acheter (Seuil, 2014).
[2] Lassave préfère, à cette expression usuelle, celle de « espace épistémique particulier »
[3] L’auteur a notamment, p. 263-275, des pages fort éclairantes sur les débats autour la sociologie de la religion de Durkheim, que l’on pourra compléter par la lecture de l’ouvrage de Wiktor Stoczkowki, La science sociale comme vision du monde. Emile Durkheim et le mirage du salut, Gallimard, 2019.
[4] Cf. mon livre, La loi de 1905 n’aura pas lieu, tome I, Une impossible loi de liberté (1902-1905), (éd. de la FNSH), présenté dans la Note de ce Blog du 25 septembre 1919.
[5] Les mordu.e.s complèteront le livre de Lassave par un ouvrage collectif, dirigé par Céline Béraud, Bruno Duriez et Béatrice de Gasquet, Sociologues en quête de religion, Presses Universitaires de Rennes, 2019.
[6] Un petit indice parmi d’autres (plus hard !) les sociologues de la laïcité sont qualifiés par les médias qui veulent bien les écouter de « sociologues de la religion »)
Jean Baubérot

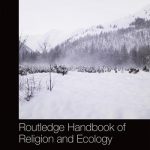
09 – 10 juin 2022 Université de Cordoue, Facultad de Filosofía y Letras Córdoba, Espagne La douzième conférence internationale sur la religion et la spiritualité... En lire plus
Le 3è congrès international de PLURIEL, sur le thème « Islam et altérité » se déroulera à Beyrouth, du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2022... En lire plus

22, rue Charles Michels
93200 Saint-Denis
Tél : 0148201515
E-mail : contact@cerii.fr
